Le degré moyen de la parole
Toute poésie a hérité d’un certain degré de style qu’elle maintient ensuite sur l’échelle de la parole, prête à en faire don comme d’une proie soumise au regard de ses lecteurs, y compris les plus pressés. Celle que je souhaite communiquer un jour aux lecteurs a été écrite dans le style « moyen », comme les océans abritent des poissons à des profondeurs moyennes, comme on peuple des villes de tailles moyennes, comme la plupart de nos véhicules sont faits pour couvrir des distances dites moyennes. Autrement dit, en voulant nommer une poésie « superficielle », on n’entendrait pas systématiquement sonner un reproche envers son éventuel défaut de consistance, mais aussi bien la formule générique pour nommer une poésie de la surface, de l’épiderme et du premier plan. On ne vanterait pas non plus, a priori, les mérites d’une poésie pour sa « profondeur » au seul prétexte qu’elle serait difficile, exigeante, recherchée, quand cela n’en dit pas moins l’enfouissement et la distance à parcourir afin de l’appréhender. Mais je voudrais encore, par cette épithète équivoque, nommer « moyens » des thèmes qui recèlent tout ce qui nous est – ou nous paraît – commun (ce qui n’exclut pas toujours le sublime) : Dieu, l’amour, la paix, le temps, l’espoir, pour évoquer les plus visibles. Si ce sont donc des thèmes de toujours, il reste qu’ils sont souvent difficiles. Le rôle de la poésie, à mon sens, c’est d’intervenir pour qu’ils soient vécus davantage comme sujets de pensées et d’expériences que comme sujets de complications avec suspension de la parole. Intervenir ? Pourquoi ? Auprès de qui ? Comment ? C’est ce que nous allons maintenant aborder successivement.
*
Un thème : l’amour
Le plus grand thème de la poésie sera toujours l’amour, car l’amour est avant tout une pensée, dont la poésie peut s’emparer par les mots. Les autres arts, pour évoquer l’amour, sont au second plan, bien qu’ils puissent accompagner ses manifestations. Lorsque Orphée descend chercher Eurydice aux Enfers, c’est sur la musique la plus subtile et la plus gracieuse, mais c’est encore guidé par les mots. Si dans tel ou tel poème un poète a traité d’un amour malheureux, il l’aura malgré tout jugé digne de poésie, car la beauté que l’amour peut contenir n’était pas réductible à son succès ou à son échec. La beauté, je la définirai comme toute chose chargée de perfection sans égard à son objet ; la beauté – à l’égal de la pensée qui se réfléchit, comme à l’égal de la parole d’autrui – serait ainsi la manifestation de l’altérité la plus complète, qui participe nonobstant de la réalité. À l’opposé, si on faisait le choix de montrer complaisamment, à l’exclusion de toute autre image du réel, une sorte d’amour qui ne se résume qu’à une morale de la réussite, on créerait lentement et sûrement un art à l’usage de l’espèce, un art darwinien, qui finalement abêtit. Ce serait alors, après la bêtise, un caractère morbide qui sèmerait innocemment la suspicion dans les consciences et attiserait notre mauvaise volonté : il viendrait mettre à mal la beauté, la vie, le rapport à l’autre et à la réalité. D’ailleurs, un trait morbide – qui ne choisit pas toujours la dernière heure pour passer son souffle glacé sur nos existences affolées – plante parfois ses dents dans la jeunesse. Mais selon Stendhal, « même les petits défauts de sa figure [chez sa maîtresse], une marque de petite vérole, par exemple, donnent de l’attendrissement à l’homme qui aime, et le jettent dans une rêverie profonde, lorsqu’il les aperçoit chez une autre femme… » (De l’amour, chap. XVII). — De manière moins visible mais parfois plus dérangeante, la folie, la psychiatrie, en marge de la raison et de la réputation courantes, constituent l’expérience morbide dont on revient, non sans mal, mais en éprouvant l’existence comme une seconde nature, peut-être parfois incertaine, mais durable et plus féconde qu’avant. La vie est partout à portée de nos gestes et de notre esprit, même sous son aspect tragique qui révulse et éloigne. Les êtres qui en restent marqués n’en sont pas moins beaux, ni moins vivants. Ils n’en sont même pas moins sages. C’est ainsi que je définis secondement la poésie comme étant la substance d’un devenir et comme l’état d’une pensée se vivant dans sa réalité tragique.
*
Lire quand on ne peut plus lire
Il est un troisième cas où la poésie intervient. Son idée implique qu’un poème comporte une rythmique et des sons harmonieux, soit des vers et des rimes. C’est la conception que j’en ai d’après mon expérience la plus courante ; ces vagues critères ne forment certes pas l’idée complète que je me fais de la poésie, mais ils la fondent certainement, et je crois ne pas être le seul à le reconnaître. La poésie n’existera et ne subsistera pas uniquement en restant une puissance d’évocation, reléguée à l’autre bout de la parole : il faudra bien la dire, la présenter. Mais mon propos n’étant pas de discuter les multiples aspects formels de la poésie, on m’accordera peut-être que la poésie première, dans l’ordre du temps, est formée et se forme par le goût pour la récitation. Qu’on s’appelât Boileau ou Villiers de l’Isle-Adam, qu’on soit élève de primaire, de sixième, ou qu’on se ressouvienne de son enfance, chacun ou presque a en mémoire, qu’il l’affectionne ou pas, le goût de réciter de la poésie. Or, l’accroissement de l’enseignement et de la diffusion des savoirs au siècle dernier masque un déficit de lecture, au moins de celle que, faute de mieux, je qualifierai de « préparée », comme peut l’être la lecture des livres de littérature. Le poème, – qui peut servir de support bien plus probant à une reconstitution de l’esprit de la lecture que tout texte en prose –, pour la simple raison qu’il est porteur de bien plus de contraintes formelles à longueur égale, soutient le regard et l’attention du lecteur démotivé, semble à première vue être le texte auquel il va le plus couramment se raccrocher. Si le rythme et les sons d’une lecture retiennent l’attention et forment la mémoire, qui se régénèrent pour former des lecteurs à un second, voire à un énième souffle, le poème en est le lieu, le support par excellence. Tout poème est une persévérance, avant d’être la persistance de quelque chose. Cette persévérance du poème prend corps dans la récitation, dont le recours à la mémoire indique la persistance. — J’ai connu des périodes où l’attention nécessaire pour lire me faisait, ou aurait voulu me faire défaut, et pendant lesquelles je m’emparais des classiques du théâtre en vers que sont Molière et, dans une mesure moindre à mon goût, Corneille et Racine, ainsi que de divers poètes, avec une prédilection pour la versification classique, particulièrement pour l’alexandrin et la rime, sans distinction particulière. Leur recours permet toujours d’ouvrir aux innovations et aux louables fantaisies, en créant des modèles lisibles et sans détour imitables.
*
Force de la poésie : l’inspiration
Je voudrais ne pas négliger, en les mentionnant pour finir, deux aspects que l’on attend de toute poésie : l’inspiration et la personnalité. La plus grande force du poète demeure l’inspiration, qui le possède comme un souffle, comme le battement de l’Instant. — Je ne me considère pas comme un mystique de la poésie, comme le sont ses inconditionnels sous influence magnétique, mais j’en parle cependant parce que j’ai suivi mon parcours dans l’activité mystique de la lecture. Les personnes qui forment le public des lecteurs, ou que l’on nomme « liseurs », sont assez rarement, pris dans leur singularité, des mystiques en poésie. Ils existent, mais j’ai tendance à voir, en chacun de celles et ceux qui lisent, des dévots de la chose lire, des lecteurs religieusement attachés aux livres, qui accueillent favorablement les poèmes. Toutefois il y a des limites : d’après l’image qu’on en a couramment, on aime dans un texte poétique davantage la légèreté que la pesanteur (même quand celle-ci est éloquente), plus volontiers la gaieté que la tristesse (même quand elle est un authentique témoignage), plus souvent l’émotion que les glaciers de l’esprit philosophique (sans aller jusqu’à l’ignorance et l’indifférence réciproques entre poésie et philosophie). C’est du moins ce que j’ai constaté au fil du temps et au gré de mes communications occasionnelles et familières : le désir d’une poésie anodine, douce et insouciante, est et sera toujours possible et recevable. En réponse à ces attentes sublimatoires, et sans tenter de devancer ni l’opinion ni le goût de la poésie, nous lui souhaitons de vivre et redonner vie aussi longtemps que les poètes lui feront prendre corps, pas seulement, pas toujours, pas définitivement en lui imprimant un caractère et un ton aléatoires qui exigent péniblement d’être compris.
Brest, janvier 2017, puis janvier 2019
David Rolland
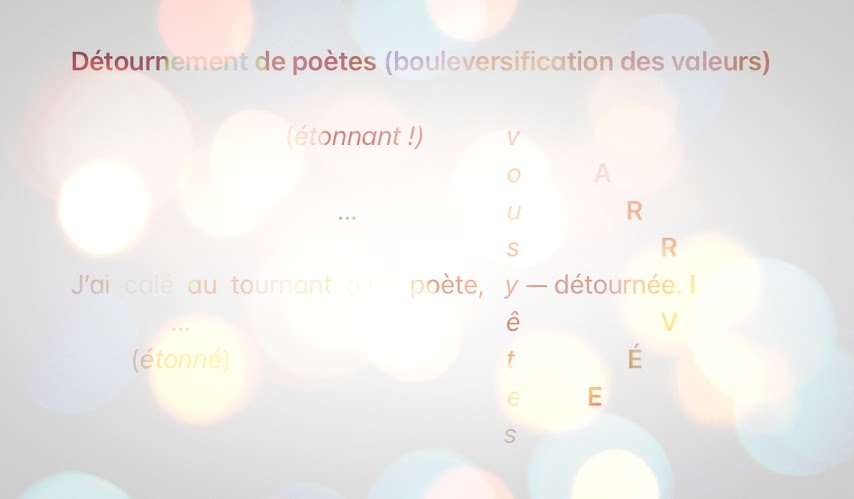


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Merci de votre aimable intérêt pour ce blog.